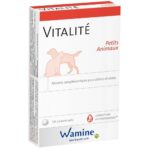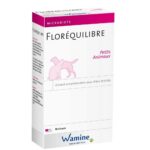Les chiens peuvent au cours de leur vie entrer en contact avec des agents pathogènes (virus, bactérie, parasite) pouvant entrainer de grave problème de santé, voir la mort. Pour prévenir certaines de ces maladies graves il existe la vaccination, un moyen simple et efficace pour protéger nos compagnons à quatre pattes de façon durable.
Pourquoi faut-il vacciner votre chien ?
La vaccination est une procédure qui consiste à immuniser un animal contre une maladie infectieuse. Le vaccin a pour rôle de faire croire à l’organisme qu’il est infecté par un virus, une bactérie ou un parasite pour qu’il produise des anticorps spécifiques. Ces anticorps seront alors disponibles et « prêts » si une réelle infection survient au cours des mois et des années qui suivent la vaccination. La vaccination a donc un réel intérêt pour l’individu propre qui est vacciné.
La vaccination est un des meilleurs moyens de lutte contre les maladies infectieuses et est utilisée aussi bien chez l’homme qu’en médecine vétérinaire. Grâce à des campagnes de vaccination systématiques elle a par exemple permis d’éradiquer la rage des carnivores de notre pays depuis 2001. Les rares cas existants mis en évidence dans notre pays proviennent de chauve-souris mais surtout de chats et de chiens importés illégalement (non ou mal vaccinés) de pays où la maladie sévit toujours !
Comme pour les êtres humains, la vaccination des chiens permet aussi de protéger l’entourage. En effet, les chiens véhiculent moins ou pas les agents infectieux (virus, bactérie ou parasite) contre lesquelles ils sont vaccinés. De ce fait, des animaux à risque qui ne peuvent pas être vaccinés car malades, trop jeunes ou trop âgés auront moins de risques de contracter ces maladies, si les animaux qui les entourent sont correctement vaccinés. La vaccination a donc aussi un intérêt collectif majeur.
La vaccination des chiens permet également de protéger l’Homme en évitant la transmission de certaines zoonoses graves et parfois mortelles (= maladies communes à l’homme et à l’animal) tels que la rage ou la leptospirose.
Dernier avantage de la vaccination du chien : la consultation vaccinale. Sur un animal en apparente bonne santé, il est facile d’oublier de se rendre chez le vétérinaire pour réaliser un check de son animal.
La consultation vaccinale est l’opportunité de présenter votre chiot pour la toute première fois à votre vétérinaire et que celui-ci soit examiné de la tête à la queue pour vérifier que tout va bien et poser toutes vos questions (comportement, éducation, stérilisation, identification, santé …). Sur un animal vieillissant, la consultation vaccinale, permet aussi de vérifier que certaines fonctions vitales de votre chien fonctionnent toujours correctement comme le cœur, les reins, le foie … en réalisant un examen clinique complet de votre animal et même en vous proposant des examens complémentaires comme vous le propose votre médecin !
Contre quelles maladies faire vacciner mon chien ?
Il est possible de vacciner les chiens contre plusieurs maladies :
Nos meilleurs produits pour chiens
Les vaccins recommandés chez le chien
La vaccination contre la maladie de Carré, l’hépatite de Rubarth, la Parvovirose et la leptospirose (CHPPiL) est considérée comme essentielle ou recommandée chez tous les chiens quel que soient leur mode de vie et leur âge.
Remarque : On inclut également dans la vaccination recommandée la vaccination contre le parainfluenza virus (Pi) qui vaccine en partie contre la maladie de la toux de chenil mais qui est déjà incluse dans le mélange du vaccin pour l’hépatite de rubarth (mécanisme de vaccination croisé)
La rage canine, bien qu’absente dans notre pays, est aussi fortement recommandée par le vétérinaire car permet de protéger votre chien de cette maladie mortelle en cas d’importation d’un cas d’un pays extérieur à proximité de chez vous. Cette maladie est de plus transmissible à l’homme et toujours mortelle une fois déclarée. La vaccination contre la rage peut être obligatoire chez le chien dans certaines circonstances. Il faut savoir aussi que pour être vacciné contre la rage un chien doit obligatoirement être identifié par identification électronique préférablement (tatouage encore toléré sur le sol français).
Les vaccins facultatifs chez le chien
Ce sont les vaccins contre la toux de chenil, la piroplasmose, la leishmaniose et la maladie de Lyme. Ces vaccinations seront recommandées par votre vétérinaire en fonction notamment de votre zone géographique et du type d’activité que vous avez votre chien. Par exemple, la vaccination contre la leishmaniose ne concerne que les chiens vivants dans des zones géographiques à risque, où le moustique phlébotome qui peut transmettre la maladie est présent (Sud de la France, bassin méditerranéen). La vaccination contre la piroplasmose et la maladie de Lyme ne concerne que les chiens vivant dans des régions où les tiques sont porteuses de ces maladies et ne vivant pas exclusivement en région urbaine par exemple.
Les vaccins contre la piroplasmose et la maladie de Lyme ne peuvent pas être réalisés en même temps que les valences essentielles (CHPPiL), au risque de provoquer des réactions allergiques chez l’animal concerné.
Cas où la vaccination est obligatoire chez le chien
Voyage en dehors du territoire français
Lorsque vous souhaitez quitter le territoire français avec votre chien celui-ci doit obligatoirement être vacciné contre la rage et posséder un passeport européen. Il faut de plus que la date de vaccination date d’au moins 21 jours avant de pouvoir voyager. En fonction du pays de destination, le délai de l’injection avant le départ peut fortement s’allonger et d’autres obligations peuvent se rajouter. Il convient donc toujours de prendre contact avec votre vétérinaire le plus rapidement possible pour connaitre l’ensemble des démarches à effectuer avant un voyage et ne pas être pris de court.
Dépôt en pension ou chenil
La quasi-totalité des pensions et chenils exigent que les chiens soient vaccinés contre l’ensemble des vaccins dit essentiels (CHPPiLR) mais aussi contre la toux de chenil dans sa totalité (Bactérie bordetella et virus parainfluenza)
Chiens dit de catégorie
Les chiens de catégorie 1 et 2, dits dangereux, doivent répondre à de nombreuses obligations, notamment être à jour de leur vaccination contre la rage.
Quand vacciner mon chien ?
Dès le plus jeune âge il est conseillé de se rendre chez le vétérinaire pour réaliser la primo-vaccination de son chien. On appelle primo-vaccination le fait de vacciner pour la première fois un animal (qu’il soit jeune ou non) ou de recommencer un protocole vaccinal à zéro sur un chien non vacciné depuis plusieurs années. Des rappels annuels plus ou moins complets sont ensuite à réaliser tout au long de la vie de l’animal. Même le chien âgé, vacciné pendant toute sa vie, doit continuer à être vacciné : en effet son système immunitaire s’affaiblit et il devient plus fragile.
Vaccination chez le chiot
Protocole général de vaccination
Depuis plusieurs années les recommandations en matière de vaccination du chiot ont évolué et encouragé à renforcer les protocoles de primo-vaccination. Il est possible de faire vacciner son chiot dès l’âge de 2 mois pour les valences dites essentielles (CHPPiL). Le protocole général consiste alors à réaliser 3 injections espacées de 3 à 5 semaines, c’est-à-dire injection à 2, 3 puis 4 mois, puis de réaliser un premier rappel complet aux 1 an du chiot et enfin un rappel vaccinal annuel comprenant tout ou une partie des valences vaccinales (en général Carré-Hépatite de Rubarth-Parvovirose tous les 3 ans et Leptospirose tous les ans, voir tous les 6 mois sur des chiens à risques).
La primo-vaccination contre la rage, elle ne peut se faire qu’à l’âge de 3 mois révolus, sur un chiot identifié possédant un passeport européen. Le rappel annuel aura lieu tous les 1, 2 ou 3 ans en fonction du vaccin utilisé par le vétérinaire.
Le vaccin contre la toux de chenil peut être réalisé en injection, avec une primo-vaccination entre 2 injections et un rappel annuel ou bien en intra-nasal, avec une efficacité au bout d’une semaine et un rappel annuel. Il peut aussi y avoir un basculement entre les deux versions du vaccin.
Le vaccin contre la piroplasmose ne peut être réalisé qu’à partir de l’âge de 5 mois et celui contre la leishmaniose à partir de l’âge de 6 mois. Il conviendra de discuter avec votre vétérinaire des différents protocoles vaccinaux si vous souhaitez réaliser certains des vaccins facultatifs existant chez le chien.
Remarque sur la vaccination du chiot
Pourquoi ne peut-on pas commencer à vacciner plus tôt chez le chiot ? Et pourquoi est-il bien important de respecter les nouvelles recommandations avec un dernier rappel de primo-vaccination à 4 mois ?
Le très jeune chiot possède des anticorps maternels qui vont tout d’abord le protéger durant ses premières semaines de vie (d’autant plus si la mère était correctement vaccinée) mais sont amenés à disparaître totalement entre le 2ème et 4ème mois de la vie du chiot. Ces anticorps maternels vont aussi contrer en partie le vaccin réalisé chez le jeune chiot puisque celui-ci est constitué d’agents pathogènes désactivés ou inactifs. Le chiot va alors créer peu d’anticorps qui lui sont propres et qui resteront dans son organisme pour le protéger à long terme, d’où l’importance de la 3ème injection de rappel vaccinal aux 4 mois du chiot, au moment où les anticorps maternels auront disparu.
Vaccination chez le chien adulte
Un chien adulte qui n’a jamais été vacciné auparavant ou pour lequel la vaccination a été abandonné peut-être vacciné à tout moment. Le protocole de primovaccination à l’âge adulte est alors différent de celui du chiot.
Pour la maladie de Carré, l’Hépatite de Rubarth et la Parvovirose (CHP), une seule injection vaccinale est nécessaire suivie d’un rappel tous les 3 ans. Pour la Leptospirose il faudra réaliser deux injections à un mois d’intervalle puis un rappel annuel. Pour la rage, une seule injection sera nécessaire avec comme pour le chiot un rappel tous les 1, 2 ou 3 ans en fonction du vaccin utilisé.
Pour les maladies à vaccin facultatif comme la toux de chenil, la piroplasmosme … le protocole vaccinal sur un chien adulte est le même que pour un chiot. Il faut toutefois se rappeler que certaines de ces vaccinations ne peuvent pas être réalisées en même temps que les autres. Il conviendra alors de discuter avec votre vétérinaire traitant d’un calendrier de vaccination sur l’année.
Faut -il faire vacciner son chien tous les ans ?
Pour résumer ce qui a été dit précédemment : parmi les vaccins considérés comme essentiels et recommandés, le vaccin contre la leptospirose est a réalisé tous les ans voire tous les 6 mois. Il y a donc au moins un vaccin à refaire tous les ans pour être sûr que son chien est correctement protégé. Quant aux autres vaccins essentiels ils peuvent être efficace jusqu’à 3 ans.
Il est donc important de respecter le calendrier vaccinal établi par votre vétérinaire pour être certains que la protection recherchée est bien atteinte et maintenue dans le temps. N’oublions pas aussi l’intérêt de la visite annuelle de contrôle chez le vétérinaire sur un chien qui apparaît en bonne santé !
Quel est le coût de la vaccination chez le chien ?
Le prix de la consultation vaccinale chez le chien comprend d’une part :
- Le prix de la consultation chez votre vétérinaire, puisqu’on ne vaccine normalement un animal qu’après qu’il a été examiné et ausculté pour ne pas mettre en évidence de contre-indication ;
- et d’autre part les valences vaccinales qui seront réalisées. Plus le nombre de valence vaccinale réalisée est important, plus le prix sera important. A savoir aussi que certains vaccins comme celui de la piroplasmose, la leishmaniose …, moins fréquemment réalisés, sont aussi plus chers que ceux des maladies dites essentielles.
Le prix de la consultation vaccinale varie aussi fortement d’un département à l’autre. Par exemple elle sera plus chère à Paris que dans le Cantal ! Il peut aussi être variable au sein d’un même département : il peut être plus cher si on se rapproche des grandes villes. Au sein d’une même ville, il peut aussi être variable entre les différentes cliniques vétérinaires puisque ceux-ci sont libres de fixés leur prix (les charges d’une clinique vétérinaire sont très différentes les unes des autres fonctions du local, du nombre de salariés …)
Une consultation vaccinale, à l’échelle du territoire français, coûte de 50 à 90€ en fonction des valences vaccinales injectées par le vétérinaire et du lieu où vous vous trouvez.
A savoir que le passeport européen, obligatoire lors de la vaccination contre la rage, coûte une quinzaine d’euros (prix une nouvelle fois variable en fonction des endroits) mais une fois délivré, il est valable durant toute la vie de l’animal (alors que le carnet de santé délivré par votre vétérinaire lors de la première visite de votre chiot est gratuit et offert).
Nos meilleurs produits pour chiens
Existe-t-il des contre-indications à la vaccination chez le chien ?
La vaccination ne peut être réalisée que sur un animal en bonne santé. L’existence d’une maladie au moment du rappel vaccinal peut entraîner le vétérinaire à repousser le moment de l’injection. De même, chez un chien plus ou moins âgé avec une ou des maladies chroniques plus ou moins invalidantes, il conviendra de discuter avec votre vétérinaire de l’intérêt de maintenir la vaccination (balance bénéfices/risques). Enfin, des antécédents de réactions allergiques graves à de précédentes injections vaccinales contre-indiquent la vaccination de votre compagnon sur certaines valences mais pas forcément toutes.
Quels peuvent être les effets secondaires liés à la vaccination ?
Les effets secondaires ou indésirables les plus souvent rencontrés à la suite de l’injection vaccinale sont :
- De la douleur et/ou un nodule au point d’injection qui disparaissent en quelques jours.
- De la fatigue pendant les 12 à 24h suivantes.
Ces effets secondaires sont déjà peu fréquents et ne sont jamais graves. En cas de douleur ou nodule important, le chien peut être présenté à son vétérinaire pour recevoir une des anti-inflammatoires si nécessaires.
Les effets secondaires graves sont extrêmement rares et arrivent soit au moment de l’injection (dans les secondes qui suivent) sois dans les 2-3 jours. Si votre chien se trouve mal 15 jours après un vaccin il n’y a aucune raison que cela soit en rapport. Il faudra chercher une autre cause à son problème.