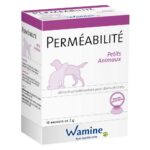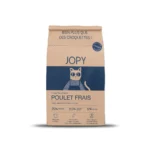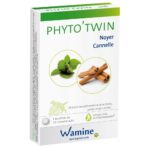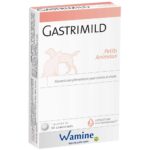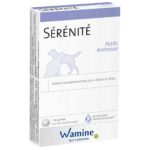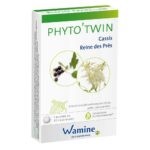Votre chat salive plus que d’habitude et bave ? Vous vous demandez si cela est normal ou si vous devez consulter rapidement votre vétérinaire. Et c’est bien normal. Les causes d’hypersalivation chez le chat sont nombreuses et n’ont pas toute la même gravité. Un vétérinaire vous aide ici à faire la part des choses et vous conseille sur la démarche à adopter.
Goodbro c’est LA boutique en ligne pour les amoureux des chiens et des chats. Retrouvez notre sélection de produits d’alimentation, de parapharmacie et accessoires pour vous aider à prendre soin de la santé et du bien-être de votre animal. Tous nos produits référencés ont été validés par notre équipe de vétérinaires conseils !
Un chat qui bave ça ressemble à quoi ?
Hypersalivation : définition
Un chat qui bave de manière excessive peut être la conséquence de deux choses :
- Soit le chat produit de la salive en quantité plus importante que la normale. On parle alors de «ptyalisme» ou d’hypersalivation en langage médical.
- Soit le chat n’arrive pas à avaler sa salive et elle ressort en coulant par sa bouche. Dans ce cas-là, le chat n’hypersalive pas au sens strict du terme mais l’impression est la même puisqu’il bave abondamment.
Dans cet article nous parlerons de toutes les causes qui font baver le chat en général. Qu’elles soient à l’origine d’une véritable hypersalivation ou non.
Symptômes en cas d’hypersalivation chez le chat
Se rendre compte que son chat bave est assez évident. Les propriétaires de félins passent rarement à côté d’un symptôme aussi évident.
La salive, c’est le liquide translucide produit par les glandes salivaires dans notre bouche et la gueule de nos animaux de compagnie. La salive a plusieurs rôles comme lubrifier la cavité buccale, aider à la mastication et à la déglutition des aliments.
Quand un chat bave, on va observer ce liquide transparent, parfois mousseux, couler entre la commissure des lèvres. Les poils autour de la bouche, voire du menton, sont mouillés. La salive peut parfois avoir une teinte rosée ou rouge, si elle est mélangée avec du sang. En général, l’odeur qui ressort à proximité de la gueule de l’animal est plutôt mauvaise. S’ils ont mal à la bouche, les chats vont arrêter de faire leur toilette et leur pelage sera terne et sale.
En fonction de la cause sous-jacente, d’autres symptômes peuvent être observés : vomissements, abattement, anorexie, vocalises, difficultés à manger, toux …
Il n’y a aucun rapport entre l’importance de l’hypersalivation et la gravité de la cause sous-jacente !
Les causes non pathologiques d’hypersalivation chez le chat
Votre chat peut se mettre à baver sans que sa santé soit en danger. Il n’y a donc pas toujours lieu de s’inquiéter.
Mon chat bave quand je le caresse
Une salivation excessive peut arriver quand votre chat est heureux. Cela peut se produire quand vous le caressez, quand vous lui apporter sa nourriture préférée, qu’il a repéré une proie ou pendant une séance de jeux. Dans ce cas-là, l’hypersalivation n’est pas associée à d’autres symptômes et elle s’arrête quand votre chat retrouve son calme. Le comportement de votre poilu est assez évocateur : ronronnement, pétrissement avec les pattes, roulade … Tout va alors très bien !
Mon chat bave quand il dort
Ce n’est pas fréquent mais cela peut arriver. Comme pour nous. Rien de glorieux mais pas besoin d’être embarrassé non plus. Si votre chat arrête de baver quand il est réveillé pas de raison de s’inquiéter.
Mon chat bave quand il est stressé
C’est souvent dans ce cas-là que les propriétaires de chats ont l’habitude de voir leur chat baver. Une visite chez le vétérinaire par exemple ou un trajet en voiture et voilà que votre compagnon et sa cage de transport sont trempés. Cela veut juste dire que votre chat à peur et est angoissé. Rien d’alarmant pour sa santé en tout cas. Si cela se produit régulièrement, n’hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire. Il existe des solutions naturelles pour lutter contre les épisodes de stress chez le chat : phéromones apaisantes, herbes aux chats (cataire, valériane), protéines de lait …
Les causes pathologiques d’hypersalivation chez le chat
Dans de nombreux cas, une production de salive en excès peut être due à une pathologie. Si votre n’arrête pas de baver et/ou que vous identifiez d’autres symptômes, prenez rendez-vous chez le vétérinaire.
Nos produits recommandés pour chats
Problèmes dentaires ou dans la cavité buccale
Les maladies buccales peuvent générer de l’hypersalivation. Citons, par exemple, la maladie parodontale et le tartre, la gingivo-stomatite chronique, les ulcères buccaux, les cancers de la cavité buccale ou encore les abcès dentaires.
Le syndrome gingivo-stomatite félin est une maladie très fréquente du chat domestique et de plus en plus diagnostiquée. Il s’agit d’une maladie chronique qui peut être liée à la présence de virus tels que le Calicivirus mais pas toujours. Elle entraîne une douleur importante et les chats ont tendance à baver.
La présence de corps étrangers buccaux est également une cause d’hypersalivation. Cette affection est fréquente chez le chien (morceau de bois ou hameçon plantés) mais est plus rare chez le chat qui est plus prudent en ce qui concerne son comportement alimentaire.
Les maladies de la cavité buccale s’accompagnent également d’une modification du comportement alimentaire de l’animal. En présence d’une gêne ou d’une douleur buccale, l’animal malade aura tendance à préférer les aliments humides et mous (pâtée, ration ménagère) plutôt que les aliments secs et durs (croquettes, bâtonnets à mâcher).
Intoxication
L’exposition d’un animal à un toxique est une des principales causes d’hypersalivation.
Rappelons que les plantes d’ornement, d’intérieur ou d’extérieur, sont, pour certaines des plantes toxiques. Nos animaux de compagnie apprécient parfois mâchonner les feuilles de ces plantes. Ce comportement peut provoquer des inflammations de la cavité buccale à l’origine d’hypersalivation et, dans les cas les plus sévères, des symptômes graves.
L’ingestion de produits toxiques tels que des produits ménagers, insecticides … peut aussi faire saliver de façon excessive le chat (autres symptômes associés). Attention aussi aux crapauds !
Soyez vigilant et assurez-vous que l’environnement de vie de votre chat ne possède pas de dangers potentiels. En cas de doute, n’hésitez pas à prendre conseil auprès de nos vétérinaires en ligne.
Prise de médicament
La prise de médicament intentionnelle ou non peut aussi entraîner une hypersalivation chez le chat. Cela peut faire partie des effets indésirables inscrits sur la notice de certains médicaments, qu’ils soient ingérés voire administrés par voie oculaire (comme l’atropine) ! Si votre chat se lèche à l’endroit où vous avez appliqué la pipette d’antiparasitaire, cela peut aussi le faire baver.
Maladies du chat qui peuvent entraîner une hypersalivation
L’hypersalivation peut être le signe d’un trouble plus général du tube digestif (gastrite, hépatite, pancréatite, etc.) mais peut également être un symptôme d’une maladie non digestive, par exemple, l’épilepsie, le coryza, l’insuffisance rénale chronique, coup de chaleur …
Conduite à tenir en cas d’hypersalivation chez le chat
Vous l’aurez compris, les causes d’hypersalivation chez le chat sont nombreuses et de gravité très variable.
Si votre chat semble aller bien mais qu’une émotion forte est présente lorsqu’il bave attendez quelques minutes pour voir tout s’arrête. Par exemple, attendez la fin de votre séance de câlin ou bien le retour à la maison après un trajet en voiture.
Lorsque l’hypersalivation est associé à une atteinte de l’état général de votre chat, lorsque ce symptôme perdure au-delà de quelques heures ou lorsque vous pensez que votre chat aurait pu s’intoxiquer, cela doit motiver rapidement une consultation chez le vétérinaire.
Si votre chat se laisse faire, vous pouvez essayer de regarder vous-même dans sa gueule pour voir si des choses sont anormales : présence de tartre, mauvaise haleine (halitose), plaies, gingivite …
Diagnostic vétérinaire si mon chat bave
Si vous consultez votre vétérinaire parce que votre chat bave de manière excessive, celui-ci essayera d’en déterminer la cause. Si la gêne semble être limitée à sa cavité buccale, un examen de celle-ci sera nécessaire. Parfois le vétérinaire n’a pas d’autre recours que de procéder à une anesthésie pour pouvoir examiner la gueule de votre chat quand celui-ci est douloureux.
En fonction des symptômes votre vétérinaire pourra vous proposer des examens complémentaires : bilan sanguin, échographie abdominale, radiographie … La prise en charge dépendra entièrement de l’état de votre animal, des symptômes et des hypothèses (intoxication ou non notamment).
Quels traitements chez le chat qui bave ?
Il n’existe pas de traitement spécifique à l’hypersalivation chez le chat. Celui qui sera mis en place servira à traiter la cause ce qui permettra de stopper le phénomène.
En présence d’une atteinte de la cavité buccale, le vétérinaire sera presque toujours obligé de tranquilliser votre chat pour faire le point sur les lésions et apporter les soins nécessaires à sa guérison. En présence d’anomalies dentaires (tartre, abcès, fractures dentaires), le vétérinaire réalisera un détartrage, un polissage et, si nécessaire, des extractions dentaires. En présence de gingivo-stomatite, le vétérinaire pourra prescrire des gels buccaux pour soulager l’inflammation des gencives et les assainir et, pour les cas les plus sévères, des anti-inflammatoires et/ou des antibiotiques en présence d’une infection. Parmi les solutions naturelles, des gels à base d’aloe vera peuvent également être appliqués sur les gencives de votre animal pour les soulager.
En cas d’intoxication avérée ou suspectée il faut vous rendre en urgence chez votre vétérinaire. En fonction du toxique responsable de l’hypersalivation votre vétérinaire pourra essayer de faire vomir votre chat. N’essayez pas de faire vomir votre chat seul à la maison avec des remèdes de grande mère car vous risqueriez d’aggraver les symptômes. Souvent une hospitalisation avec une perfusion est nécessaire. Le vétérinaire peut aussi faire avaler du charbon à votre animal pour empêcher les toxiques contenus dans le tube digestif d’être absorbés. Les autres traitements dépendront de l’intoxication diagnostiquée.
Si c’est une maladie plus générale qui fait baver votre chat. Votre vétérinaire vous proposera un traitement adapté.
Comment éviter que mon chat ne bave ?
Vous ne pourrez pas empêcher votre chat de baver s’il ressent des émotions fortes. Cependant, si c’est le stress qui le fait baver régulièrement, discutez avec votre vétérinaire des solutions à votre disposition pour réguler son anxiété.
Le maintien d’une bonne hygiène dentaire chez le chat permet de prévenir l’apparition de tartre et de gingivite, qui à terme sont douloureux. Pour cela, il est conseillé d’habituer le plus tôt possible votre animal au brossage dentaire et réaliser ce brossage a minima 3 fois par semaine au cours de sa vie. Le brossage dentaire est plus aisé chez le chien mais peut tout à fait être effectué chez un chat coopératif et habitué aux manipulations. Si le brossage dentaire n’est pas réalisable chez votre chat, utilisez des dentifrices en poudre ou à croquer plusieurs fois par semaine.
Enfin, limiter le risque d’intoxication accidentelle à la maison. Evitez si possible d’acheter des plantes d’ornements toxiques. Si vous en avez déjà, vous pouvez proposer à votre chat de l’herbe à chat à grignoter pour le détourner des autres plantes. Rangez bien vos produits ménagers, vos médicaments et faites attention aux aliments que vous donnez à votre chat.
Nos produits recommandés pour chats
Mis à jour 09/2022 par le Dr Pradel Tatiana